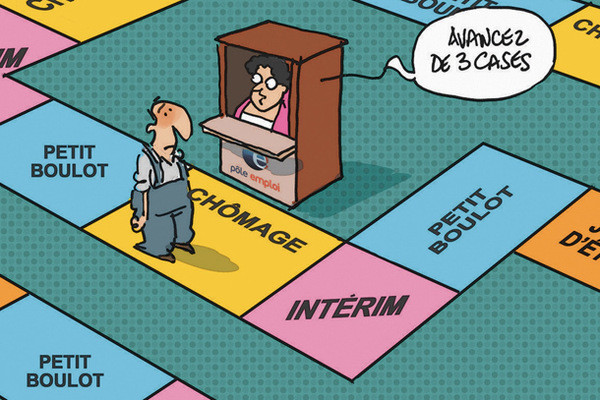Journalistes, sûrement pas, nous n’avons pas cette prétention à MetaMorphosis. Blogueurs amateurs nous ira bien. Pour la plupart des membres du Collectif, faire vivre le site est une expérience, parfois compliquée, mais enrichissante. Jongler avec différents supports, parvenir à maintenir une diffusion continue, suivre les commentaires et y répondre, chercher de nouveaux axes de développement, se remettre en question… tout ceci est nouveau et formateur, tout ceci est difficile car réalisé avec quatre bouts de ficelles, mais valorisant. MetaMorphosis est un site d’information et de réflexion réalisé par des lanceurs d’alerte pour des lanceurs d’alerte. En réalité tout ceci est possible et grisant car nous y avons notre liberté de ton, de pensée, nécessairement engagée et au bénéfice de la défense d’une cause. D’autres ne pensent pas comme nous, ne voient pas les choses comme nous, nous profitons de nos tribunes pour leur apporter la contradiction, arguments contre arguments, démonstrations contre démonstrations. Il faut parfois y revenir, retourner au combat, mais un simple combat de mots.
Comme chaque année, Reporters sans Frontières (RSF) dresse son classement mondial de la liberté de la presse. La carte s’est encore un peu plus assombrie l’an passé.
Bilan : en 2017, 21 pays ont été placés en situation « très grave ». Un niveau record. L’Irak bascule ainsi dans la catégorie où figurent déjà plusieurs régimes autoritaires comme l’Égypte (161e), la Chine (176e) ou la Corée du Nord, toujours en dernière position. Seulement, les discours de haine et les attaques contre la presse ne sont à présent plus l’apanage des seuls États autoritaires.
Quatre des plus forts reculs enregistrés se situent en Europe : la République tchèque, dont le président Milos Zeman s’est présenté lors d’une conférence de presse avec une kalachnikov factice portant l’inscription « pour les journalistes », dégringole de 11 places à la 34e ; la Slovaquie, où l’ex-premier ministre Robert Fico a traité les journalistes de « sales prostituées anti-slovaques » et « simples hyènes idiotes » ; Malte, où une journaliste anti-corruption a été assassinée, chute de 18 places au 65e rang ; et la Serbie en perd 10 (77e). Les États-Unis de Donald Trump, pays du 1er amendement qui sacralise la liberté d’expression, perdent quant à eux deux places au classement et tombent au 45e rang.
Ce classement traduit un phénomène malheureusement manifeste, « la croissance dans bon nombre de démocraties de l’expression de la haine contre les journalistes, et la libération de cette haine est vraiment dangereuse », résume Christophe Deloire, secrétaire général de l’organisation. Un phénomène qui touche, selon lui, des démocraties aussi différentes que les Philippines (133e), avec le président Duterte qui prévient qu’être journaliste « ne préserve pas des assassinats », qu’en Inde (138e), où des armées de trolls à la solde des partis politiques appellent à la haine des journalistes, ou les États-Unis, où Donald Trump les qualifie «d’ennemis du peuple» une formule prisée par Staline.
Reporters sans frontières s’alarme de la multiplication des violences verbales contre la presse en Europe, où deux journalistes ont été assassinés ces derniers mois : le Tchèque Jan Kuciak et la Maltaise Daphne Caruana Galizia. Si la Norvège maintient son 1er rang au classement, «il y a une inquiétude très forte pour les démocraties européennes», estime Christophe Deloire. Alors que l’Europe est de loin le continent où la liberté de la presse est la mieux garantie, ce modèle européen s’affaiblit : 4 des 5 plus grandes baisses du classement sont en Europe, la zone dont l’indice global en plus grande dégradation c’est l’Europe, et l’expression de la haine mène in fine à des violences physiques.
La France ne fait pas exception. Bien qu’elle progresse de 6 places, au 33e rang, un mouvement lié principalement au recul de plusieurs pays voisins, RSF y relève que «le mediabashing», ou le dénigrement systématique de la profession par certains leaders politiques, a connu son paroxysme pendant la campagne électorale de 2017, et que certains responsables continuent d’utiliser cette rhétorique pour attaquer les journalistes quand ils sont mis en difficulté. Aux yeux de l’ONG, ce climat délétère envers la presse sape l’un des fondements essentiels des démocraties.
Le Monde du 08 Mai 2018 «La stratégie de « haine des médias » de Jean-Luc Mélenchon inquiète Reporters sans frontières», (ici), nous indique que «pour illustrer son propos, l’organisation non gouvernementale a notamment mis en avant les fréquentes sorties de Jean-Luc Mélenchon envers les journalistes».
«La citation mentionnée par RSF est issue d’une note de Jean-Luc Mélenchon publiée sur son blog le 26 février 2018. Le président du groupe La France insoumise à l’Assemblée y écrivait que «si la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine, elle ne doit pas nous empêcher de réfléchir et de penser notre rapport à eux comme une question qui doit se traiter rationnellement dans les termes d’un combat».
Il qualifiait ensuite la presse de «première ennemie de la liberté d’expression» en avançant que le «parti médiatique […] inoculait de la drogue dans les cerveaux» — avant de conclure que «le pouvoir médiatique est d’essence complotiste».
«Cette déclaration s’inscrit dans une longue série de sorties hostiles à des journalistes. En 2010, déjà, le responsable politique qualifiait un étudiant en journalisme venu l’interviewer entre les deux tours des élections régionales de « petite cervelle» au service d’un «métier pourri», d’une « sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier». En mars 2014, c’est au tour d’un journaliste de «La Nouvelle Edition», une émission de Canal+, qui tentait de l’interroger de se faire traiter «d’abruti» et de «vermine».
Lors de la dernière campagne présidentielle, le 18 mars 2017, M. Mélenchon insultait de «sale con» et d’«hyène» un journaliste de «C à vous» qui l’interrogeait sur sa stratégie vis-à-vis de Benoît Hamon».
On va peut-être s’arrêter là, MetaMorphosis n’est pas un dictionnaire en ligne de noms d’oiseaux…
Le problème est que justement, derrière ces mots, il y a des choses.
Évacuons tout de suite le procès en bigoterie qui pourrait nous être fait, de méconnaître l’état de la presse française, les enjeux de pouvoirs qui s’y jouent, sa participation dans sa grande majoritaire à la reproduction du discours officiel, ses arrangements avec la réalité, sa conception partisane de certaines vérités.
D’une part parce que nous avons déjà à plusieurs reprises dans ces lignes, évoqué et alerté sur ces questions, d’autre part car en notre qualité de lanceurs d’alerte nous sommes sûrement les mieux à même, parce que victimes directes de cet état de fait, à dénoncer l’aveuglement et la connivence d’une grande partie de la presse française avec les lieux de pouvoir. Il reste fort heureusement quelques îlots de résistance, tournés vers l’investigation, la volonté de comprendre et la pédagogie d’expliquer, qui fournissent encore les armes de la réflexion et de la contradiction.
Réflexion ne vaut pas nécessairement adhésion. Débats, échanges ne justifient pas ces discours de haine, ces mots derrière lesquels il y a des choses bien précises. Le spectre des assassins de la liberté d’informer est vaste, de l’extrême droite à une certaine gauche, en passant par ceux qui se nomment républicains pour mieux s’en convaincre. La force dominante reproduit le discours dominant au travers des médias dominants : rien de bien original.
Ceci donne-t-il pour autant carte blanche à ceux qui s’en estiment exclus, de mettre toute la profession au pilori ? Sous prétexte que certaines associations se sont emparé du discours sur les lanceurs d’alerte, ces derniers doivent-ils leur nier même leur droit d’exister ? Où n’est-il pas plus judicieux de reprendre la parole, sa parole, et de la diffuser ? Certains ont eu la prétention de le faire : nous voyons le résultat, fait de divisions, d’absence de contradiction, d’aménagements grossiers avec la vérité, du bon travail de presse mainstream en somme.
« …le pouvoir médiatique est d’essence complotiste… » : derrière les mots, il y a des choses.
Mélenchon n’est pas prêt d’aider les lanceurs d’alerte puisqu’il n’a toujours pas compris la différence entre la délation et la dénonciation. Ça nous rappelle certains discours, macroniens pour le coup, où l’on considère que «par essence», le lanceur d’alerte est malhonnête et intéressé… «La haine des médias… est juste et saine» : la haine de ceux qui ne pensent pas comme nous ou qui ne sont pas comme nous ne pourra jamais être juste et saine. A priori étrange conception de la justice, de la liberté de la presse, d’une façon générale des libertés publiques et individuelles. Car si la haine devient «juste», plus aucune liberté n’est essentielle. Nous voyons ici où sont les modèles, en Russie, en Turquie ou au Venezuela, ces pays où une bonne presse c’est une presse morte, c’est une presse aux ordres.
Alors à MetaMorphosis, nous ne faisons pas beaucoup de différence entre ceux qui veulent faire taire la presse et la contestation au travers d’une loi secret des affaires et ceux qui l’inscrivent «d’essence» comme une activité néfaste et dangereuse.
Ne prenons pas à la légère l’avertissement de RSF. Les libertés fondamentales sont attaquées de front, même dans les pays qui jusque là les défendaient le mieux.
Le fossoyeur n’avance plus masqué et si sa parole s’est libérée, c’est pour mieux enfermer celle des autres.
L’un des symboles des régimes fascistes du siècle dernier est le brasier de livres sur la place publique. La chose publique (res-publica) est alors devenue son cimetière.
N’attendons pas que ces gens brûlent la presse sur l’autel de leurs ambitions de petit napoléon.
MM.