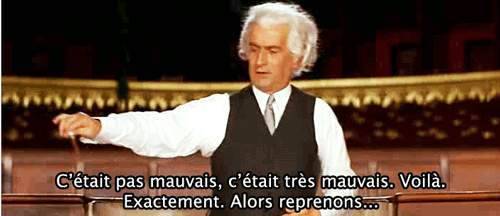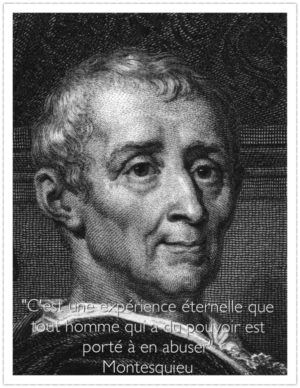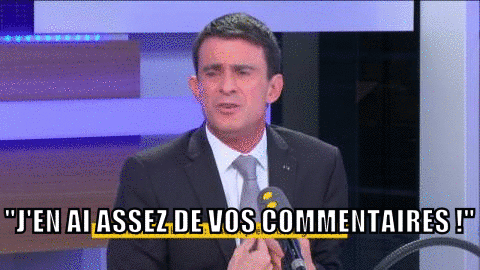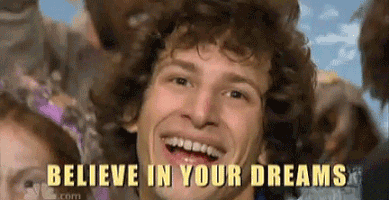Les récentes péripéties de l’affaire Sarkozy – Kadhafi et la publication par Médiapart du contenu des auditions du désormais mis en examen, nous donnent l’occasion de revenir brièvement sur une situation bien connue des lanceurs d’alerte. Sarkozy innove peu, prisonnier qu’il est de ses mensonges, recopiant ce qui semble être une stratégie de communication et de défense bien huilée que l’on retrouve dans quasiment toutes les affaires d’alerte. Elle repose sur un principe invariant : «j’ai tous les pouvoirs, mais je ne sais rien».
Nous pourrions en fait la décrire en plusieurs étapes, sans prétention d’être totalement exhaustifs selon les cas :
➡️ La victime. L’alerte vient d’être lancée, les premières dénonciations deviennent publiques : l’accusé est tout de suite la victime d’une horrible machination qui vise à salir son honneur et sa probité. Tout n’est que mensonges, diffamations, l’accusé n’a pas de doute que « toute la lumière sera faite », il fait totalement confiance dans la justice. Il convient simultanément de renverser l’accusation en insinuant que le lanceur vise un intérêt personnel, une volonté évidente de nuire pour des raisons obscures, non dites, mais nécessairement immorales.
➡️ Droit dans ses bottes. Une instruction judiciaire est ouverte, la presse commence à s’intéresser à l’alerte: la partie incriminée continue sa petite litanie sur « la machination de forces occultes » mais doit tout de même commencer à se justifier. On a alors droit au célèbre «nous avons toujours respecté les lois et les règles des pays dans lesquels la société exerce». Peu importe que cette affirmation soit vraie (elle ne l’est pas souvent), nous en sommes au stade du parole contre parole, et que vaut la parole d’un seul homme contre une société, ses relais et ses médias ?!
➡️ « Rien à déclarer ». De nouvelles informations, une avancée des procédures, viennent infirmer la position officielle de l’accusé : pas de soucis, s’il y a de nouveaux éléments, de nouvelles accusations, ils ne feront que confirmer ce qui est affirmé depuis l’origine c’est à dire que le lanceur d’alerte a « une volonté évidente de nuire »! Il convient alors d’inverser la relation de pouvoir en insinuant que l’accusateur dispose d’une force de frappe énorme (journalistes complices, justice pas totalement impartiale) et que l’accusé est « la victime d’une machination de forces de tout ordre qui vise à lui faire plier le genou ».
Mais, l’accusé-victime est fort, car sûr de sa probité, il n’a rien à cacher mais il ne répondra à aucune question. C’est là aussi un grand classique des affaires d’alerte, celui qui n’a rien à se reprocher ou à cacher, refuse systématiquement d’expliquer pourquoi il n’a rien à se reprocher ou à cacher… Le secret de l’instruction c’est quand même bien sympa.
➡️ « On m’a rien dit ». Certains éléments de l’instruction viennent démontrer que les motivations initiales de la dénonciation sont fondées : il devient difficile maintenant de continuer à affirmer l’inexistence des faits dénoncés. On note alors une première inflexion. Pour celui en position de pouvoir il n’est toujours pas question de reconnaître qu’il aurait pu être informé de l’existence des dysfonctionnements (d’autant plus s’il y a directement participé), sans pour autant continuer à nier qu’ils existent. On en vient alors à ce que l’on pourrait appeler la «défense par hiérarchies» : ceux qui étaient en charge de… ont affirmé que tout allait bien, qu’ils avaient fait le nécessaire, que tout était conforme. «J’ai le pouvoir mais je ne peux pas tout faire, donc je me repose sur des gens de confiance». «M’auraient-ils mentis ?». C’est une excellente défense car elle permet à celui qui a le pouvoir de se repositionner très rapidement en victime de ses propres équipes.
➡️ « C’est pas moi, c’est l’autre ». Cette étape consiste à passer de l’impersonnel à l’identifiable. On transfère alors une responsabilité éventuelle de l’organisation à une ou des responsabilités individuelles. «Ce n’est pas moi, c’est X, lui il savait, pas moi». Cela permet de dédouaner l’organisation même de la société (meilleure façon pour ne rien changer) et donc de la relation de pouvoir en son sein en identifiant des responsabilités individuelles nécessairement sous entendues comme étant intéressées et malhonnêtes.
Lors de son audition devant les policiers, Sarkozy s’est clairement situé à ce niveau -après être passé par les précédentes phases- en chargeant ses ex-fidèles sur le thème «je ne sais pas mais si quelqu’un sait quelque chose c’est forcément eux».
Nier et se défausser, telle est pratiquement toujours la stratégie des accusés en situation de responsabilité. Nous pouvons parler de lâcheté, sans aucun doute, mais nous avons affaire, dans l’organisation du capitalisme d’entreprise français, même en dehors à toutes accusations ou dénonciation, à un système qui déconnecte totalement pouvoir et responsabilité. Le monde politique n’est pas en reste et cette fois-ci encore, fonctionne en symbiose totale avec celui de l’entreprise.
Celui en situation de pouvoir, incapable d’assurer ses responsabilités fonctionnelles, que ce soit par incompétence ou par connivence, doit être traité comme un co-accusé des fautes commises. C’est sans doute une des pistes qui, à notre sens, pourrait redonner légitimité et efficacité aux organisations hiérarchisées.
MM.
En référence aux articles de :
Le Monde du 24 Mars 2018 «Devant les policiers, Nicolas Sarkozy a souvent plaidé l’ignorance», (ici).
Médiapart du 24 Mars 2018 «Sarkozy en difficulté devant les policiers» (ici).