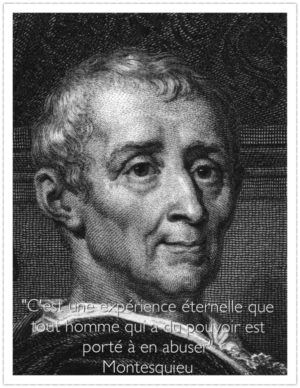Dans son édition du jour, «La Cour de cassation exclue du champ de compétence de l’inspection générale de la justice» par Jean-Baptiste Jacquin (ici), Le Monde nous informe d’une décision importante mais pas entièrement satisfaisante : «La plus haute juridiction administrative vient au secours de la plus haute juridiction judiciaire. Le Conseil d’Etat a décidé, vendredi 23 mars, d’exclure la Cour de cassation du champ de compétence de l’inspection générale de la justice (IGJ) créée par la précédente majorité».
Il n’est pas inutile de rappeler d’abord quelques principes qui semblent s’être évaporés de la conscience du personnel politique et sans doute de beaucoup de citoyens. Théorisée par Montesquieu afin de garantir la liberté – «Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» -, la séparation des pouvoirs a été intégrée dans l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sous la formule «toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution». Sont alors envisagés les pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
Faisons ensuite, sur l’affaire qui nous occupe, un petit rappel des faits et du contexte de cette décision politique.
A peine avait-on fini de s’étonner des propos tenus par l’ex Président de la République, François Hollande, qui qualifiait l’institution judiciaire d’«Institution de lâcheté», un nouveau coup était porté à l’autorité judiciaire, cette fois-ci par Manuel Valls, la veille de son départ du gouvernement. Le 5 décembre 2016, par un décret qui a été publié au journal officiel le 6 décembre 2016, il a été subrepticement créé une Inspection Générale de la Justice chargée d’une «mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation des juridictions judiciaires», y compris la Cour de cassation. L’Inspection Générale de Justice est chargée «d’apprécier l’activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d’une mission d’enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles».
Ces dispositions qui auraient pu passer en douce, compte tenu du climat politique de l’époque, n’ont pas manqué d’indigner les membres de la Cour de cassation qui ont immédiatement interpellé le nouveau Premier ministre, Bernard Cazeneuve, dans un courrier en date du 6 décembre 2016, co-signé du Premier Président Bertrand Louvel et du Procureur général Jean-Claude Marin. Ces hautes autorités invoquent alors une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, cher à notre République, et demandent à être reçues immédiatement par le Premier ministre en s’appuyant sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui, dans des termes clairs, pose le principe de la séparation des pouvoirs : «toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution».
De prime abord, on aurait pu considérer que la nouvelle Inspection Générale était de bon sens car elle doit centraliser les compétences qui étaient jusque-là dévolues à l’Inspection des Services Judiciaires. Toutefois, celle-ci n’avait pas la compétence d’évaluer le travail de la Cour de cassation, juridiction judiciaire suprême, qui était cependant évaluée d’une part par elle-même et d’autre part par la Cour des comptes. Le problème qui se pose avec ce décret, outre le fait qu’il ait été créé sans consulter les magistrats et sans qu’il fût signé par le Président de la République, garant de l’autorité judiciaire, est que l’Inspection Générale de la Justice reçoit ses ordres de l’Exécutif, ce qui porte vraisemblablement atteinte à la Séparation des Pouvoirs.
Nous pouvons alors penser que sa mission est en dehors de l’activité juridictionnelle, mais le décret n’en dit rien. Même si le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas estimait que nul ne compte placer les juridictions du premier ou du second degré sous le contrôle direct ou indirect du gouvernement, nous pouvons légitimement s’inquiéter d’une instrumentalisation car, comme le soulève le Professeur Roseline Letteron, «La formule n’interdit pas un contrôle sur la manière dont les arrêts sont rendus, voire sur leur contenu».
Le 8 décembre 2016, le Garde des sceaux a rencontré le premier président de la Cour de cassation et le Procureur général. Dans un communiqué livré le même jour, ceux-ci ont dénoncé la place dévalorisée donnée à la Cour de cassation, juridiction judiciaire suprême et proposent que l’Inspection Générale de la Justice soit plutôt placée sous l’autorité du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est déjà investi d’une mission générale d’information à l’égard des juridictions.
A la manœuvre (c’est le cas de le dire), un Manuel Valls sortant et un Jean-Jacques Urvoas, parfait politicien fait de suffisance, certitudes toutes faites, et donneur permanent de leçons. Il n’est pas inutile de rappeler ce qu’il est advenu de ces deux sinistres personnages : le premier est allé, à son habitude, d’échecs en échecs, humilié à la primaire du Parti socialiste par un ancien (sous)-ministre et au final ridiculisé à la présidentielle par son ancien jeune subalterne ; le second, est sous enquête de la Cour de Justice de la République pour avoir, en qualité de Garde des Sceaux, violé le secret judiciaire (ça ne s’invente pas!), outre une «petite» affaire de détournement de fonds publics. Il n’est pas inutile de rappeler le sombre parcours de ces deux personnes pour mieux comprendre leurs motivations à placer le pouvoir judiciaire sous la coupe de l’exécutif.
La décision du Conseil d’État est donc d’importance. Le Monde nous explique le contexte de cet arrêt : «La section du contentieux du Conseil d’État considère que compte tenu de sa dépendance à l’égard du garde des sceaux et donc du gouvernement, l’inspection générale de la justice ne doit pas avoir de droit de regard sur l’institution du quai de l’Horloge sans porter atteinte à l’indépendance de la justice. «Eu égard tant à la mission ainsi confiée par le législateur à la Cour de cassation, placée au sommet de l’ordre judiciaire, qu’aux rôles confiés par la Constitution à son premier président et à son procureur général, notamment à la tête du Conseil supérieur de la magistrature chargé par la Constitution d’assister le président de la République dans son rôle de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, le décret attaqué ne pouvait légalement inclure la Cour de cassation dans le champ des missions de l’inspection générale de la justice sans prévoir de garanties supplémentaires relatives, notamment, aux conditions dans lesquelles sont diligentées les inspections et enquêtes portant sur cette juridiction ou l’un de ses membres», peut-on lire dans la décision du Conseil d’État. Il annule en conséquence l’article 2 du décret attaqué».
Néanmoins, cette décision n’est qu’une victoire en demi-teinte : le contrôle par le pouvoir politique de la pratique professionnelle d’un magistrat est une atteinte à l’indépendance de la justice. Le Conseil d’État estime que les garanties sont pourtant suffisantes.
Une nouvelle fois, la France est le seul pays d’Europe dans ce cas de figure. Dans les pays où un service d’inspection existe auprès du ministre, il contrôle l’activité des juridictions, pas celle des magistrats.
Si dans sa décision le Conseil d’État a justifié le bien-fondé de telles inspections puisque le gouvernement doit pouvoir contrôler les dépenses dont il est responsable devant le Parlement, il a aussi relevé que la publication d’un rapport d’inspection par le ministre «pourrait constituer un moyen de déstabiliser une juridiction».
Ce risque persiste. Il semble de plus en plus urgent pour nos politiques de revenir à une lecture approfondie de Montesquieu.
MM.