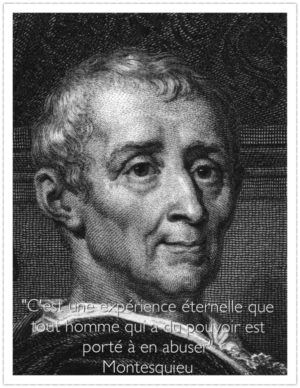Laissons Bolloré où il est, chez le juge… On ne va pas encore blâmer le milliardaire breton, entendu ce jour (ici) dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l’attribution de concessions portuaires à son groupe, au Togo et en Guinée, en 2010.
Sarkozy il y a quelques semaines, Bolloré aujourd’hui, la justice française se mettrait-elle au diapason ? Reconnaissons-lui une réelle volonté, des résultats à venir espérés, dans un environnement politique peu favorable, la grande loi de moralisation de la vie politique ayant accouché d’une souris, les quelques « mesurettes » contre la corruption n’étant pas de nature à changer la donne, et les gardes-fou posés ici et là (secret des affaires, plaider-coupable, convention judiciaire…) constituant autant d’obstacles nouveaux à un exercice serein de la justice. Au mieux le gouvernement macronien pourra se satisfaire de la critique bienveillante de Transparency International France qui va finir pas se transformer en association de défense des causes perdues. Dans tout cela, peu de politiques condamnés, en tous les cas pour faits de corruption ; c’est à croire que la France serait une exception, un îlot protégé de Jupiter dans un océan de corruption. N’est-ce pas aller un peu vite en besogne ?
Ce qui est sûr c’est que nos politiques sont les rois du slogan. Quand il s’agit de crier « haro à la corruption », « la corruption ne passera pas par moi »… il y a du monde sur les grands chevaux. C’est un mal quand même très français : condamner oui, combattre peut-être !
Revenons aux faits, aux seuls faits.
La lutte contre la corruption n’est plus un slogan dans de nombreux pays. De très nombreux ministres sont écartés du pouvoir et se retrouvent devant les prétoires où ils sont souvent condamnés à de lourdes peines. Les anciens chefs de l’État et de gouvernement ne sont plus épargnés par la justice.
On ne badine pas avec la probité en Israël : l’ancien Premier ministre Ehud Olmert, avait été condamné en 2016 à 27 mois de prison ferme pour corruption et entraves à la justice. Il a accompli seize mois de détention pour être libéré le 2 juillet 2017. Il avait rejoint en prison l’ancien chef de l’État israélien Moshe Katzav, condamné à sept ans de prison ferme en 2011, pour viol et entraves à la justice. L’ancien détenu est sorti de prison en décembre 2016 après avoir accompli cinq années de détention. L’actuel Premier ministre, Benjamin Netanyahou, est actuellement dans la mire de la police qui aurait réuni des preuves de corruption, de trafic d’influence et d’abus de confiance. L’intéressé nie ces graves accusations mais les faits paraissent suffisamment probants pour une éventuelle comparution en justice.
Le Brésil malade de la corruption : après ses deux mandats de chef de l’État, l’ancien président syndicaliste brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, avait été remplacé, le 1er janvier 2011, par son ancienne chef de cabinet, Dilma Rousseff, vainqueur de l’élection présidentielle. La grande proximité entre les deux personnalités n’a pas empêché l’ancien président Lula d’être repris par la justice, pour de graves accusations de corruption. Il s’est finalement constitué prisonnier, le 7 avril 2018, pour une peine de douze ans de prison. Dilma Roussef, à son tour, a été mise en cause par la justice par des scandales de corruption. Elle a été contrainte à la démission par le Sénat, le 31 août 2016. Le vice-président, Michel Temer, lui a succédé. Les mêmes soupçons de corruption et de trafic d’influence notamment dans les scandales du groupe de BTP Odebrecht et Petrobras menacent de plus en plus sa présidence.
Le scandale Odebrecht éclabousse l’Amérique latine : le scandale du géant brésilien des BTP, qui a institutionnalisé la corruption, n’affecte pas que le Brésil. Les anciens chefs de l’État du Pérou, Ollanta Humala, Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski ont dû démissionner et rendre des comptes à la justice.
Quasiment tous les États d’Amérique latine sont aussi concernés par ce scandale. Des ministres, des magistrats, des proches des chefs de l’État sont pris dans les filets de la justice.
L’Asie n’est pas à l’écart : l’ancienne présidente de la Corée du Sud, Park Geun-Hye, destituée et arrêtée en mars 2017, a été condamnée, le 6 avril 2018, à 24 années de prison pour abus de pouvoir et corruption.
En Afrique, le mouvement « mains propres » a commencé : la justice sud-africaine est souvent montrée en exemple. Elle a mis en accusation le président Jacob Zuma pour une vielle affaire d’armement ayant donné lieu à des pots-de- vin impliquant Thomson-CDF devenu Thales. Jacob Zuma a dû finalement démissionner, le 24 février 2018. Il attend son procès prévu en juin 2018.
Les proches de l’ancien président angolais Eduardo Dos Santos sont de plus en plus sérieusement mis en cause pour des affaires de détournement de fonds publics et de corruption. L’ancien président pourrait bientôt être en première ligne des accusés.
Le successeur de Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe s’attaque à la corruption qui y est endémique. Déjà plusieurs ministres de la ZANU ont été arrêtés. L’épouse de Robert Mugabe est aussi dans le viseur de la justice et pourrait entraîner, in fine, le vieux leader qui a déjà été contraint d’abandonner la présidence.
La présidente de l’île Maurice, Gurib-Fakim, a été contrainte à la démission pour avoir utilisé une carte bancaire d’une ONG à des fins personnelles.
Les États africains, notamment ceux d’Afrique dite francophone, doivent accroître la lutte contre la corruption qui nourrit la mal gouvernance et perpétue le sous développement. Il est vrai que certaines puissances investissant en Afrique ne facilitent guère cette éradication, à l’image de la France, ancienne puissance coloniale.
Nous pourrions sauter sur l’occasion pour revenir à Bolloré, mais nous éviterons, même si les faits pour lesquels il est actuellement interrogé sont en droite ligne avec ce qui vient d’être évoqué.
A prendre un peu de recul, nous voyons que des têtes tombent, parfois dans des pays où nous ne nous l’attendions pas, et des têtes d’en haut, Présidents, Premiers Ministres, Ministres, hauts fonctionnaires… avec des condamnations lourdes et exécutées.
Qui manquent-ils à ce palmarès ? Combien de politiques européens poursuivis et condamnés pour corruption ? Quelques rares cas en Italie, en Espagne… et puis c’est tout.
Serions-nous si vigilants, si bien organisés que toute corruption est rendue impossible ? Nos lois, organes de contrôles, conditions d’exercice des mandats publics… seraient-ils si bien agencés, qu’il n’y aurait rien à trouver ? Le travail des lobby serait-il si bien encadré, ici, là et à Bruxelles, que toute tentative de corruption est vaine ?
Nous sommes en train de tomber dans ce que nous dénoncions : le slogan.
Souhaitons que la justice mène à son terme l’affaire (les affaires ?) Bolloré. Espérons qu’elle n’accouche pas d’une maintenant célèbre « lagardise » (une condamnation sans peine pour une broutille de 405 millions d’euros).
Exigeons surtout que la classe politique française et le législateur sortent enfin de leur hibernation face à la corruption, que leurs œillères leur en tombent, qu’ils sortent maintenant du seul slogan pour remettre ce chantier sur le métier.
Condamner c’est bien, combattre c’est mieux.
MM.