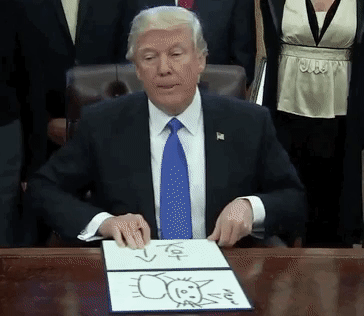Il y a des jours comme ça, on se dit que ça va être une bonne journée…
Dans son édition du jour, Le Monde (ici) nous informe du départ du «numéro deux» de la Société Générale : le directeur général délégué, Didier Valet, quitte en effet le groupe vendredi.
Comme l’indique le quotidien : «La justice américaine a le bras long. Très long». On se fait tout de suite plaisir avec «l’explication obscure» de la banque : «à la suite d’une différence d’appréciation dans la gestion d’un dossier juridique spécifique du groupe, antérieur à son mandat de directeur général délégué, Didier Valet, soucieux de préserver l’intérêt général de la banque, a présenté sa démission».
Décidément, le ridicule ne tue pas, sinon la Société Générale serait morte depuis longtemps. Après les «fake-news» made in Société Générale, la vérité : le départ de Didier Valet a été imposé par les autorités judiciaires américaines, à l’image du débarquement de membres de l’état-major de BNP-Paribas suite à l’accord conclu en mai 2014 concernant la violation des embargos américains, qui s’était traduit par une amende pharaonique de 9 milliards de dollars (7,3 milliards d’euros). Outre l’affaire du Libor, la Société générale négocie avec la justice outre-Atlantique pour régler deux autres litiges. «Comme BNP Paribas, Deutsche Bank ou le Crédit agricole avant lui, l’établissement fait d’abord l’objet d’une enquête de l’OFAC, le bureau du Trésor américain qui gère les sanctions financières à l’encontre de ceux ayant contourné les embargos américains à l’encontre de l’Iran, Cuba ou le Soudan. Ensuite, il doit répondre à des accusations de corruption concernant ses opérations avec le fonds souverain libyen Libyan Investment Authority (LIA)».
Pour comprendre ce que les Etats-Unis reprochent désormais à la Société générale, il faut se rappeler comment fonctionne le Libor. Ce thermomètre du marché monétaire est déterminé chaque jour à Londres à partir des déclarations des banques partenaires qui indiquent à quel taux elles empruntent au jour le jour.
Sur le Libor, la Société générale est accusée d’avoir minoré, entre mai 2010 et octobre 2011 ses déclarations quotidiennes de taux, afin de ne pas apparaître fragilisée durant la crise de l’euro en révélant qu’elle empruntait plus cher que ses concurrents, signe d’une défiance de la communauté financière. En août 2017, la justice de l’Etat de New York a inculpé deux salariées de la trésorerie du groupe, Danielle Sindzingre et Muriel Bescond. Ce sont elles qui déterminaient au sein de la banque les estimations transmises à Thomson Reuters, le gestionnaire du Libor. La justice américaine les accuse d’avoir « délibérément » donné des estimations basses concernant le Libor en dollar. «Si la trésorerie dépend de la salle des marchés, elle est copilotée par la direction financière. Or, Didier Valet était directeur financier de la banque entre mai 2008 et décembre 2011. Il a participé à des réunions où ces questions ont été évoquées».
Pour la justice américaine, c’est impardonnable, et la sanction semble logique. Mais c’est là que le bas blesse : tout le monde au siège de la Société Générale loue «l’éthique irréprochable» de Didier Valet… Décidément les banques françaises sont incorrigibles. Parce qu’il faudra quand même nous expliquer quelque chose : comment peut-on (en même temps pour être dans l’air du temps) signer un accord avec la justice américaine valant reconnaissance de culpabilité dont celle de son numéro deux, et ne pas entamer à son encontre et de tous les autres responsables impliqués les procédures adéquates, la première victime de cette affaire étant la banque, ses actionnaires et ses salariés ? Si un gestionnaire de compte vient à voler sur les comptes de ses clients, la banque reconnaissant sa responsabilité en les remboursant, on la voit mal ne pas poursuivre son employé indélicat. Deux poids, deux mesures.
Donc ne nous réjouissons pas trop vite. Si la décision de la justice américaine est un bon signal, elle demeurera vaine si elle n’est pas de nature à modifier en plus des comportements, les mentalités. Et il apparaît malheureusement que le chemin est encore long.
Deuxième bonne nouvelle ? The Guardian (ici) nous annonce la fermeture prochaine du fameux cabinet panaméen Mossack & Fonseca. Comme pour la Société Générale, nous sommes gratifiés d’un communiqué officiel, grand art de la langue de bois : «The reputational deterioration, the media campaign, the financial circus and the unusual actions by certain Panamanian authorities, have occasioned an irreversible damage that necessitates the obligatory ceasing of public operations at the end of the current month». Voilà, bravo messieurs les journalistes, vous avez un mort sur la conscience ! Revenons, là aussi, à la vérité. L’industrie de la fraude fiscale a bon dos, Mossack & Fonseca n’est que l’un des acteurs panaméens de cette activité au demeurant tout à fait légale dans ce pays. Le problème de la fraude fiscale n’est pas une question entre des pays d’un côté, et un cabinet de l’autre, mais entre deux pays. Si certains pays européens souhaitent mettre fin à cette évasion fiscale massive, ce n’est pas avec Mossack & Foncesa qu’ils doivent traiter mais avec le Panama. C’est que l’on oublie un peu vite les autres affaires Mossack & Fonseca, mis à jour ou non lors des révélations du ICIJ, à savoir le blanchiment massif d’argent d’activités illicites (cartels de la drogue) et la fameuse affaire de corruption latino-américaine Odebrecht (groupe de BTP brésilien). Il convient en effet de rappeler que les deux associés du cabinet ont été placés en détention provisoire au Panama dans le cadre de ce scandale de corruption. Le ministère public qui les accuse de blanchiment de capitaux, avait perquisitionné leur cabinet. Selon le procureur Kenia Porcell, Mossack Fonseca est soupçonné d’être «une organisation criminelle qui se chargeait de cacher des actifs et des sommes d’argent à l’origine douteuse». Le cabinet a également pour rôle, selon elle, «d’éliminer les preuves [contre] des personnes impliquées dans les activités illégales liées au cas “Lavage Express”».
Une fois de plus, on voit qu’il y a plus d’un pas entre le discours et la réalité. Mossack & Fonseca nous quitte pour avoir industrialisé, comme tant d’autres, l’évasion fiscale ? On peut en douter… Si l’on doit bien évidemment s’en réjouir, nous sommes toujours dans l’attente d’une action forte des pays européens à l’encontre de ces territoires et de tous les intermédiaires, notamment agissant à partir de leur sol, rendant possible l’évasion fiscale. Or sur ce chapitre et à cette heure-ci, c’est plutôt le calme plat.
Allé, on cherche encore. Une success-story ? De ces histoires qui font rêver toute la macronie heureuse. C’est le Washington Post (ici) qui nous raconte cette merveilleuse histoire. Une femme, Elizabeth Holmes, jeune, blonde, partie de rien, fondatrice et Chief Executive d’une start-up… Et ce n’est pas tout, le cadre est idyllique : la Silicon Valley, les nouvelles technologies, une biotech, Theramos. Ça nous change de nos fonctionnaires qui ne pensent qu’à défendre leur statut, incapables de prendre des risques, de briser les «chaînes de l’assistanat».
Le hic, c’est qu’Elizabeth a un peu trop écouté Emmanuel. Notamment quand il conseille de ne jamais respecter les règles. Notre héroïne, alliée à son associé, n’y est pas allée avec le dos de la cuillère et ça a fini par se voir : «The SEC alleges that Holmes, Balwani and Theranos raised more than $700 million from investors by misrepresenting the capabilities of the proprietary blood-testing technology that was at the core of its business — as well as by making misleading or exaggerated statements about the company’s financial status and relationships with commercial partners and the Department of Defense». Ce qu’on lui reproche : d’avoir menti aux investisseurs, à ses clients, au marché, sur la réalité des activités de Theranos, d’avoir exagéré et trafiqué les comptes de la société… En somme, rien de bien extraordinaire !
Jina Choi, directrice du bureau régional de San Francisco de la SEC trouve les mots justes : «The Theranos story is an important lesson for Silicon Valley. Innovators who seek to revolutionize and disrupt an industry must tell investors the truth about what their technology can do today, not just what they hope it might do someday».
La leçon de l’histoire ne serait-elle pas plutôt que pour faire rêver, il faut vendre du rêve ?
Au final, on aurait bien voulu y croire … mais… Le responsable de la Société Générale, éjecté de son poste sur ordre de la justice, reste pour la banque quelqu’un à «l’éthique irréprochable». Le cabinet Mossack & Fonseca met la clé sous la porte, un autre doit être en train d’ouvrir et les pays européens regardent toujours partir l’argent…
Nos politiques vendent du rêve pour se faire élire, les entreprises aussi.
Au final, c’est une journée comme une autre.
MM.