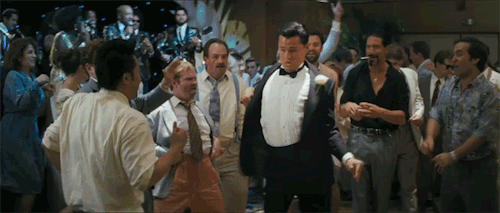Tout justiciable potentiel a bien souvent une image relativement idyllique de la justice. Il en connait ce qu’on lui a appris, ce dont on a pris soin de le convaincre, ce qui est écrit dans les textes, une justice équitable et égale pour tous. C’est l’avantage des grands principes, ils sont faciles à retenir mais tellement difficile à mettre en œuvre, si éloignés de toute réalité. Les lanceurs d’alerte sont sans doute de bons témoins de cette dichotomie. Ils ne jouent pas dans la même catégorie que les puissants : pas de hordes d’avocats payés à la ligne et surtout pas de temps à perdre. D’un autre côté, quand on n’a rien à se reprocher et qu’on est sûr d’agir de bonne foi, sans arrière- pensée, que nous sommes convaincus du bien fondé des faits dénoncés, pourquoi chercher à faire durer la procédure judiciaire? Autant en finir vite pour passer à autre chose… Cela fait partie des mystères auxquels sont confrontés en permanence les lanceurs : ils ont en face d’eux des gens outrés par les accusations portées contre eux, clamant haut et fort leur probité exemplaire, assénant qu’ils peuvent démontrer sans équivoque possible qu’ils ont toujours scrupuleusement respecté la loi… mais ils passent leur temps à chercher comment repousser le moment de la confrontation avec la vérité judiciaire. Drôle de maladie où la volonté de dire la vérité passe par la recherche permanente des moyens pour ne pas la dire !
Prenons l’exemple de l’affaire Bygmalion dont se fait l’écho Médiapart dans son édition du jour, «Affaire Bygmalion : Sarkozy joue encore la procédure», ici.
«Pour les personnalités aux prises avec la justice, la procédure pénale offre des trésors insoupçonnés permettant de jouer la montre, voire de se sauver des griffes des juges. Ainsi va l’affaire Bygmalion, que le juge d’instruction Serge Tournaire a bouclée en février 2017 en renvoyant Nicolas Sarkozy et 13 autres personnes devant le tribunal correctionnel pour « financement illégal de campagne électorale », au sujet de l’élection présidentielle de 2012.
Pour éviter un procès à tout prix, l’ex-chef de l’État et onze autres mis en examen, anciens dirigeants de l’UMP ou responsables de sa campagne, ont aussitôt saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris – notoirement engorgée, et dont les délais vont de six à douze mois –, pour faire appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et demander son annulation.
L’audience aurait dû se tenir en décembre 2017, mais à la dernière minute, elle avait été reportée à la demande des avocats, le temps qu’un point de la plus haute importance soit tranché : l’association Anticor était-elle recevable en tant que partie civile dans la procédure Bygmalion, comme l’avaient estimé le juge d’instruction puis la chambre de l’instruction ? Grave question. Il a donc fallu attendre que la chambre criminelle de la Cour de cassation tranche cela, le 31 janvier dernier, en décidant curieusement d’éjecter Anticor de cette affaire (au motif que le dossier Bygmalion ne concerne aucune des infractions mentionnées à l’article 2-23 du code de procédure pénale, et que l’association ne justifie d’aucun préjudice personnel).
Cinq mois plus tard, retour devant la chambre de l’instruction, qui a examiné plusieurs demandes d’annulation de la procédure, ce mercredi 16 mai, lors d’une audience à huis clos. La défense soutient notamment que l’ordonnance de renvoi n’est pas régulière…
L’avocat de Nicolas Sarkozy, son ami Thierry Herzog (tous deux sont renvoyés en correctionnelle dans l’affaire Paul Bismuth), a en outre plaidé la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour de cassation. Selon le mémoire de Thierry Herzog, dont Mediapart a pris connaissance, le dépassement du plafond des dépenses de campagne du candidat Sarkozy a déjà été sanctionné par la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), et ne peut donc faire l’objet de poursuites pénales…
L’audience s’est achevée vers 19 heures ce 16 mai, et la chambre de l’instruction a mis sa décision en délibéré au 20 septembre. Si elle accède à cette demande et transmet la QPC à la Cour de cassation, c’est encore plusieurs mois de gagnés pour Nicolas Sarkozy et les 13 autres personnalités renvoyées en correctionnelle, la décision sur le fond de la procédure étant à nouveau suspendue. Le parquet général de la cour d’appel de Paris, pour sa part, soutient que la procédure est régulière».
Nous avons volontairement repris dans sa longueur ce catalogue des «astuces» procédurales mises à l’œuvre pour montrer leur caractère futile et qu’elles n’ont au final que peu de rapport avec le fond du dossier, avec les faits incriminés. Exactement ce que vivent la plupart des lanceurs avec les attaques en diffamation, vols de documents… Nous pouvons maintenant faire le calcul : de l’ordonnance de renvoi de février 2017 à sans doute quelque chose comme premier trimestre 2019. Deux ans, 24 mois ! Les voies de la procédure pénale sont décidément impénétrables… Pourquoi se donner tant de mal quand on est sûr de son coup ? Mystère !
En réalité, rien de bien nouveau sous le soleil. C’est un autre Nicolas, à la différence du premier et dont l’histoire a retenu le nom, Machiavel (1469 -1527), qui nous rappelle que le souverain doit être un hypocrite démagogue incarnant en lui l’homme et la bête. Le prince, comme le nomme Machiavel, doit user des lois et de la force pour guider mais également pour conserver le pouvoir.
Pour Machiavel, tous les moyens sont efficaces quand ils sont nécessaires. Toutefois, le prince doit toujours paraître vertueux en public. Ainsi, pendant qu’il n’est pas nécessaire pour le prince d’avoir toutes les vertus, il est nécessaire pour lui de sembler les avoir. D’où la maxime machiavélienne, «gouverner, c’est dissimuler».
Tout cet exercice d’évitement de la justice, toutes ces forces déployées par la plupart des politiques mais également des dirigeants et grandes sociétés pour repousser ou faire annuler les procédures, ne visent qu’à une seule chose : paraître vertueux en public. Et c’est là que le bas blesse, car la justice, dans sa forme procédurale se fait l’écho de cette demande, participe à cette dissimulation.
MM.